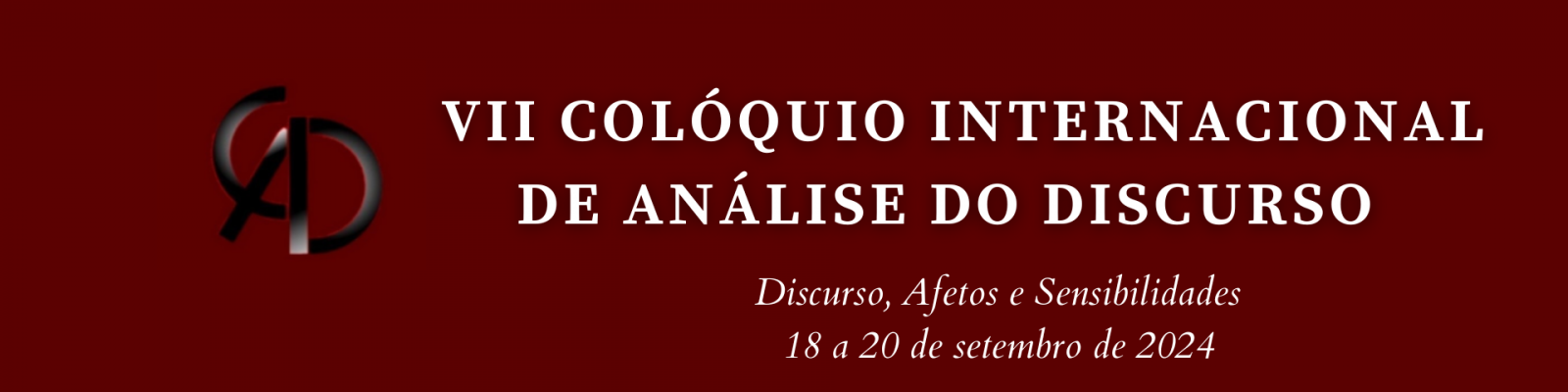Chères et chers collègues,
Nous aimerions bien vous inviter à participer du V CIAD, qui aura lieu à l’UFSCar, de 12 au 14 septembre 2018.
La cinquième édition de l’événement sera dévouée aux rapports entre le discours et la vérité et aura le titre suivant : Discours et (post) vérité : les effets du réel et les sens de la conviction. En plus de la traditionnelle participation des groupes de recherche en analyse du discours, venant de tout le Brésil et de l’extérieur, nous avons prévu pour la discussion du sujet de notre événement la tenue des tables rondes et des conférences avec specialistes nationaux et étrangers. Entre autres, ces sont déjà confirmés les participations de Roger Chartier (Collège de France), de Elvira Arnoux (Université de Buenos Aires), de Christian Delporte (Université de Versailles) et de Tales Ab’Sáber (Université Fédérale de São Paulo).
Autant les tables rondes que les conférences traiteront des diverses rapports entre le discours et la vérité dans différents domaines d’études du discours, dans différentes conditions historiques de production et dans différentes domaines institutionnelles, à savoir, la média, la politique et la vie quotidienne, entre autres. Ces seront également abordés les phénomènes dans lesquels s’entrecroisent le discours, la vérité et les protestations et les manifestations sociaux et encore l’émergence récente de notions comme « post-vérité », « fake news » et « faits alternatifs ».
Bientôt, nous annoncerons les délais et les normes d’inscription des groupes et de leurs participants dans le V CIAD.
Nous espérons pouvoir compte avec la participation de tous.
Cordialemtent,
***
Discours et (post) vérité : les effets du réel et les sens de la conviction
Il y a des rapports diverses et fondamentales entre le discours et la vérité. Au cours de l’histoire, en conditions de production distinctes, on a déjà été dit que la vérité existerait indépendamment des choses dites ; que ces dernières seraient des obstacles ou un accès à la véritable essence des êtres et des phénomènes ; et, finalement, que la vérité consisterait une construction historique des faits, pour laquelle le discours est décisif. Plus récemment, nous avons vu se multiplier les allégations dont les faits n’existent pas, de sorte qu’il n’y aurait que de versions et de interprétations alternatives.
En outre, nous savons que dans différents temps et lieux, ces ne sont pas les mêmes champs et institutions d’où s’émanent les effets du réel et des convictions. L’unique, mais profond et significatif, exemple de cette transformation est le « désenchantement » du monde occidental, qui survenu dans notre époque moderne. Avec lui, nous avons vu la religion perdre sa force comme espace pratiquement exclusif de production de la vérité, à travers la reproduction de la parole de Dieu, en cédant de plus en plus le lieu aux données et aux expériences de la pratique scientifique.
En ce qui concerne les tendances contemporaines de concevoir les rapports entre le discours et la vérité, elles sont souvent conçues comme un mouvement libertaire, lorsqu’elles permettraient que nous détachent de dogmes, de orthodoxies et d’autorités exclusives. Ainsi, les domaines et les institutions, qui, avant, nous guidaient sur la base de leurs vérités fondamentales et sur la presque aveugle foi des autres, ces sont rendus de plus en plus suceptibles à nos doutes et critiques. La religion, la polique, la média et la science ne sont plus de la même façon considerées comme les mines de laquelles germeraient la certitude de faits et les chemins adequats à suivre. Avec une fréquence et une intensité apparemment sans précédents, la croyance et la confiance que nous y avons déposité elles ont passé à être entourées par des scepticismes, des suspicions et, ainsi, peut- être, par émancipations. Ceci ne signifie pas qui soyons en face d’un phénomène homogène et également expérimenté par sujets qui ont des classes et des groupes sociaux distincts, des idéologies variées et qui sont inscrits en différents relations de pouvoir.
D’ailleurs, nous observons que la diffusion croissante des fake news et l’émergence des notions de « post-vérité » et de « faits alternatifs » ont produit des effets pervers. Les revers politiques et sociaux, les intolérances au comportement, les adhérences aux préjugés de classe et de genre et la diffusion massive d’idées et d’actions réactionnaires ou populistes se consolident et se développent avec une force et une portée effrayantes. L’omniprésence des réseaux sociaux, leur utilisation constante et généralisée, et leurs interconnexions avec des organes médiatiques d’extraits et d’idéologies divers, contribuent de manière décisive à cette force et à cette portée. Les résultats de ce mouvement dans l’histoire ont déjà été vus: attaques contre des politiques affirmatives, programmes de lutte contre les inégalités sociales et économiques, et discussions sur le genre et la sexualité; et la montée des tendances fascistes de toutes sortes, menant des dirigeants politiques d’extrême droite à des victoires électorales jusqu’à récemment inimaginables en Europe et aux États-Unis, mais aussi au Brésil.
Dans les différents aspects des études discursives, ils dérivent de l’AD française, des travaux qui sont basés sur le cercle de Bakhtin ou Semiótica, Greimas, entre autres, il existe un consensus relatif sur le fonctionnement des processus discursifs. De tels processus font que les mêmes mots, expressions ou propositions produisent différents effets de sens, mais provoquent aussi des mots, des expressions et des propositions différents pour produire les mêmes significations. Dans la foulée de cette réflexion, nous pouvons comprendre que les diverses rapports entre le discours et la vérité, qu’elles soient catégoriquement affirmées, soumises à la critique ou à l’adhésion partielle, sont toujours absolument rejetées, ils peuvent libérter autant que assujettir. Ils peuvent souscrire à des positions conservatrices et induire des discours réactionnaires et même fascistes, mais ils peuvent aussi dériver de positions progressistes et produire des pensées, des actes et des mots émancipateurs.
Des intervenants avec présence confirmé :
Roger Chartier
Professeur au Collège de France et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS/Paris) et auteur, entre autres, des ouvrages suivants: As origens culturais da Revolução Francesa (Éditions UNESP 2009) ), A ordem dos livros (Éditions da UNB 1994), A aventura do livro: do leitor ao navegador (Éditions UNESP / Presse Oficielle 1998), O que é um autor? Revisão de uma genealogia (EdUFSCar, 2012), Inscrever e apagar. Cultura escrita e literatura (Editora UNESP 2007). Parmi d’autres prix et titres, il a remporté en 1990 le prix de l’Annual Award de l’American Printing History Association et en 1992, il a reçu le Grand Prix Gobert de l’Académie Française.
Elvira Arnoux
Professeur à l’Université de Buenos Aires, directeur de recherche à l’Institut de Linguistique UBA et auteur, entre autres, des ouvrages suivants: Practicas y representaciones del linguaje (Eudeba 1999), La lectura y la escritura en la universidad (Editora da UBA 2004), El discurso americanista de Hugo Chavez (Biblos 2008), Analisis del discurso: modos de abordar materiales de archivo (Santiago Arcos 2006), Unasur y sus discursos. Malvinas: integracion regional, amenaza externa (Byblos 2012). Entre autres prix et titres, il a reçu en 2009 le Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Filología (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle); et en 2015 le prix de la Fondation Alexander von Humboldt (Université Leibniz).
Christian Delporte
Professeur à l’Université de Versailles, chercheur et auteur, entre autres, des ouvrages suivants: (PUF 1995), Histoire des médias en France. De la Grande Guerre à nos jour (Flammarion 2003), Une histoire de la langue de bois (Flammarion 2009), (Flammarion 2011), Les grands débats politiques. Ces émissions qui ont fait l’opinion (Flammarion 2012), Histoire de la presse en France(Armand Colin 2016). Il est le president de la Société pour l’Histoire des Média et editeur de la revue Le Temps des Médias.
Tales Ab’Sáber
Professeur à l’Université Fédérale de São Paulo, psychanalyste et écrivain. Il est licencié en Cinéma par l’École de Communucations et d’Arts de l’Université de São Paulo (USP), où il est devenu maître en Arts. Il est psychologue par l’Institut de Psycologie de l’USP avec un doctorad sur la clinique psychanalytique contemporaine. Actuellemtent, il est membre du Département de Psychanalyse de l’Institut Sedes Sapientiae et enseignant de philosophie de la psychanalyse de l’UNIFESP. Il est auteur, entre autres, des ouvrages suivants : O Sonhar Restaurado – Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud (Ed. 34, lauréat du prix Jabuti). En 2012, il a publié A Música do Tempo Infinito, sur la culture techno et la subjectivation contemporaine (Cosac Naify), livre également lauréat avec le Jabuti. En 2015, Dilma Rousseff e o ódio político (Ed. Hedra), en plus de nombreux essais dans revues spécialisés.